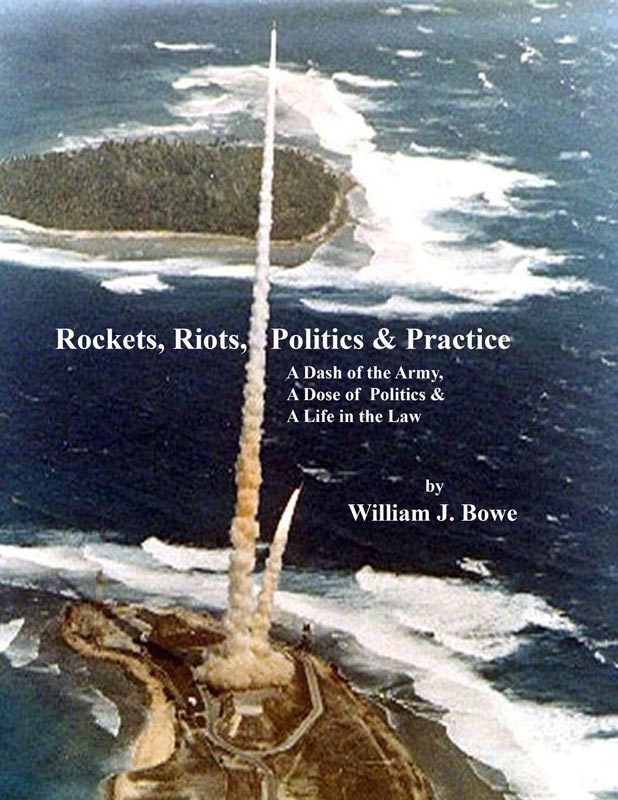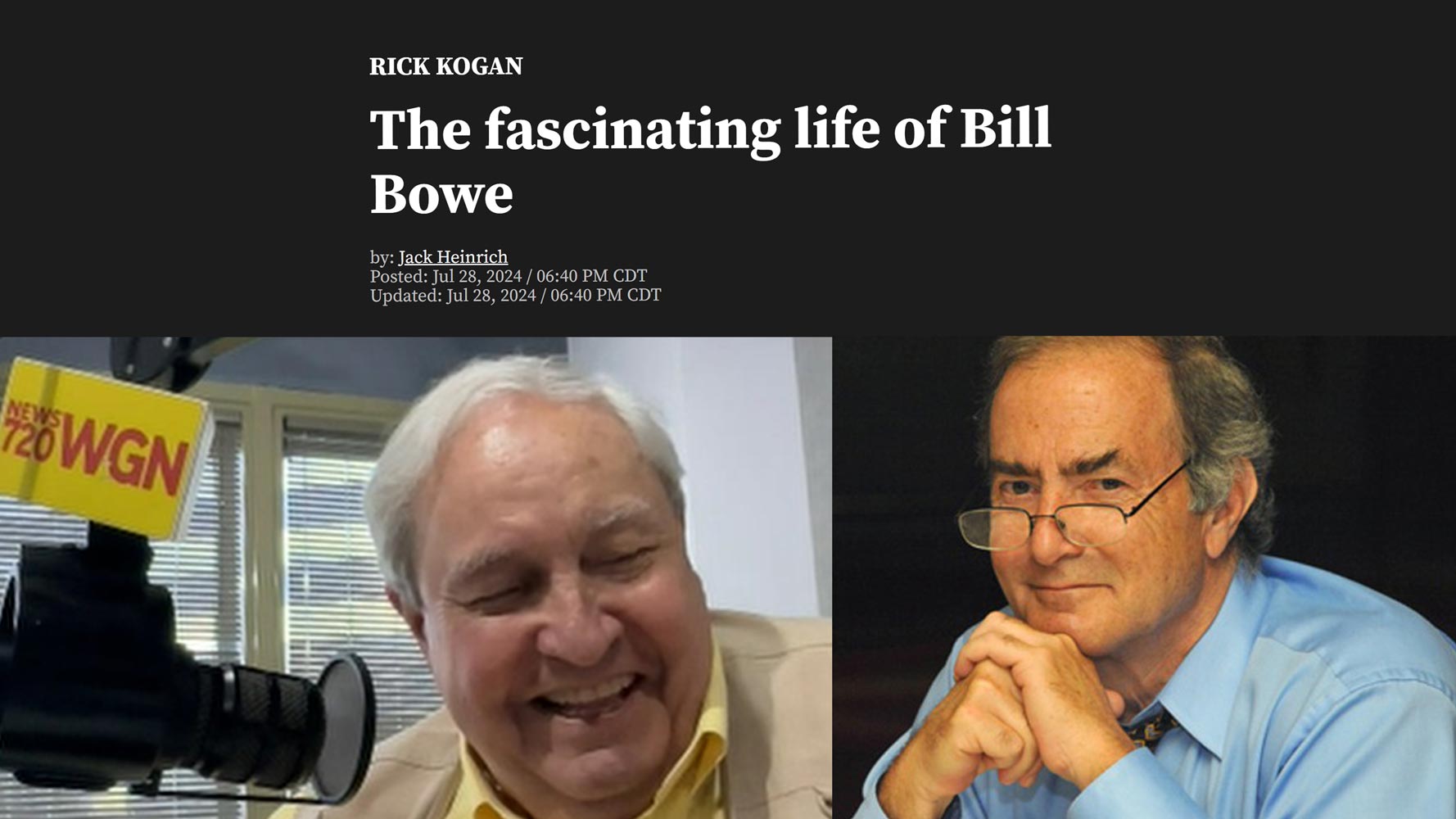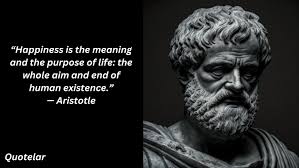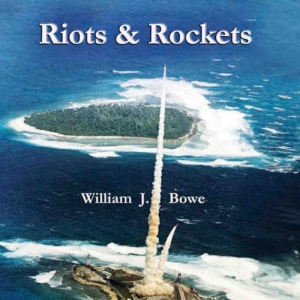Introduction
Le mois suivant l’assassinat du Dr Martin Luther King, Jr. en 1968, je me suis enrôlé dans le service de renseignement de l’armée pour trois ans. Le président Lyndon Johnson venait d’envoyer simultanément l’armée régulière à Baltimore, Washington et Chicago pour aider à contrôler la violence et les émeutes qui avaient submergé la police et la Garde nationale. C’était une époque très étrange et violente. Nous avons eu la chance que le pays soit largement épargné par ce genre de pagaille et de destruction à grande échelle, jusqu’aux récents pillages et émeutes auxquels nous avons assisté pendant la pandémie de l’été 2020.
Après huit semaines de formation de base et 16 semaines de formation individuelle avancée à l’école de la branche des services de renseignement en 1968, l’armée m’a placé au cœur de la violence raciale et anti-guerre de cette époque. J’ai été affecté au Pentagone et je me suis presque immédiatement retrouvé chargé de fournir des estimations des troubles civils susceptibles d’impliquer l’armée.
Ayant appris quelque chose sur les aspects de renseignement du contrôle des troubles civils lorsque j’étais dans l’armée, on m’a demandé de témoigner devant le Congrès en 1974 sur le sujet de la surveillance militaire. Mon témoignage a été présenté devant la commission judiciaire du Sénat américain. Témoignage sur la surveillance militaire Dans le cadre de la préparation des auditions sur la surveillance militaire, j’ai rencontré en privé le président de la commission, le sénateur Sam Ervin (D-NC), et j’ai eu l’occasion de discuter de ces questions avec lui de manière approfondie. Rencontre avec le sénateur Ervin Pour une personne d’une telle gravité, il était aussi avenant et terre-à-terre que possible. L’année précédente, j’avais été fasciné, comme la majorité du pays, par le fait qu’Ervin présidait les audiences les plus importantes de sa carrière, les audiences du Sénat sur le Watergate. Son contre-interrogatoire de John Dean et des autres témoins du Watergate a contribué à la démission du président Nixon.
Ces réflexions sur mon service dans l’armée entre 1968 et 1971 n’abordent pas seulement le vaste bouleversement civil qui se produisait à l’époque. Ils donnent également un aperçu de ce que j’ai vu de certaines technologies militaires avancées de l’époque sur des atolls isolés de l’océan Pacifique. Ce qui m’a le plus rapproché du Vietnam pendant mon service, c’est qu’on m’a demandé d’entreprendre une évaluation des menaces de contre-espionnage et de contre-sabotage qui m’a conduit sur les atolls de Johnston et de Kwajalein dans le Pacifique.
Si l’on peut dire que l’ère atomique a commencé avec le largage de la bombe atomique sur Hiroshima en 1945, on peut dire que l’ère spatiale a commencé avec le lancement par l’Union soviétique du premier satellite Spoutnik en 1957. Le Spoutnik ressemblait à une balle de médecine qui émettait un signal sonore : il était rond, mesurait environ deux pieds de diamètre et envoyait par gazouillis la preuve de sa présence sur terre. Personne ne pensait alors à l’abattre en 1957. En 1962, cependant, les fusées anti-missiles balistiques Nike-Zeus avaient déjà été testées sur l’atoll de Kwajalein pour voir si elles pouvaient effectuer une mission anti-satellite. La menace perçue est celle des satellites en orbite de l’U.R.S.S. avec des armes nucléaires à bord. Les fusées Nike-Zeus de l’époque n’ont littéralement pas réussi à remplir cette tâche. Ils ne pouvaient pas voler assez haut.
En 1969, lorsque je me suis arrêté à l’atoll de Johnston, dans le Pacifique, en route vers Kwajalein, j’ai vu des missiles Thor récemment modifiés qui pouvaient tuer des satellites. Le système antisatellite basé sur le Thor du projet secret 437 du ministère de la Défense a été mis en veilleuse l’année suivant ma visite. Au-delà des contraintes budgétaires, les tests ont montré que les détonations nucléaires qu’elle devait utiliser pour éliminer les satellites hostiles détruisaient des satellites utiles. Parmi les victimes involontaires du programme 437 figurait Telstar, le premier satellite de télécommunications au monde. Newton Minow, mon prédécesseur au poste de conseiller juridique de l’Encyclopaedia Britannica et, en 1962, commissaire fédéral aux communications du président John Kennedy, avait vanté son arrivée lors de la première émission de télévision transatlantique diffusée en direct sur Telstar. J’ai eu l’occasion de parler de Telstar et de certaines de ces questions. de défense contre les missiles balistiques et les satellites satellite à l’occasion de la conférence Le Cliff Clif Dwellers juste avant le blocage de la pandémie au début de 2020.
Bien que je ne l’aie pas compris à l’époque, le développement de systèmes de satellites militaires offensifs et défensifs du type de ceux que j’ai vus et auxquels j’ai pensé en 1969 a, d’une certaine manière, marqué l’émergence de l’espace comme un théâtre de guerre distinct et nouveau. L’évolution de la guerre vers une plateforme non terrestre a pris du temps depuis lors et n’a été officiellement reconnue qu’en 2019. C’est l’année où l’U.S. Space Force a été créée et s’est vu confier les missions principales de défendre nos villes contre une attaque spatiale et de protéger nos satellites militaires et de navigation contre une attaque depuis l’espace ou la terre.
En post-scriptum à ce récit de mes années d’armée, lorsque j’étais avocat général de United Press International en 1985, j’ai eu l’occasion improbable d’avoir des entretiens avec des membres de l’armée. Déjeuner avec le général William Westmoreland (États-Unis) Ret.)Il s’agissait du commandant des troupes américaines au Vietnam, alors à la retraite, et de l’ancien chef d’état-major de l’armée de terre, à l’époque où je travaillais au Pentagone. Il venait de régler son procès en diffamation de 120 millions de dollars contre CBS. À l’époque, on a considéré qu’il jetait l’éponge sur une proposition perdante. Notre conversation a confirmé la justesse de l’adage de Winston Churchill : « Les généraux font toujours la dernière guerre. »
Parallèlement à ma pratique du droit dans les années 1970, j’ai travaillé bénévolement pour Bill Singer et Dick Simpson, tous deux conseillers municipaux libéraux et non machinistes des 43e et 44e circonscriptions du bord du lac, dans le nord de Chicago. Bill Singer et moi avons pratiqué le droit dans les mêmes cabinets d’avocats et nous nous sommes brièvement croisés en tant que beaux-frères lorsque nous étions mariés à des sœurs. J’ai été avocat général et directeur de recherche dans la campagne de Singer contre le maire de Chicago Richard J. Daley lors des élections primaires démocrates de 1975 et j’ai ensuite rédigé des ordonnances pour Simpson. J’ai également assumé la fonction de secrétaire du 43e district du bureau des conseillers municipaux lorsque Marty Oberman, le successeur de Singer, a pris ses fonctions. J’avais également tenté sans succès d’être élu membre du comité démocratique du 43e arrondissement de Chicago en 1979.
Pendant cette période, j’écrivais aussi occasionnellement des articles pour des publications locales de Chicago sur des sujets commerciaux et politiques. Ce dernier rôle m’a jeté de façon inattendue au milieu d’une tempête politico-médiatique qui a éclaté en 1980 lorsque le maire Jane Byrne a fait une bourde et a banni le Chicago Tribune de l’hôtel de ville. L’histoire était à la fois bizarre et révélatrice. C’était bizarre parce que toute l’affaire était complètement farfelue et c’était révélateur parce que cela a mis en évidence certains des défauts sous-jacents du maire. Ce sont ces défauts qui ont contribué à faire d’elle un maire à un seul mandat. L’histoire que je rappelle ici n’est qu’un des événements qui ont contribué à préparer le terrain pour l’arrivée en 1983 du premier maire noir de Chicago, Harold Washington.
Après avoir passé plusieurs années à la tête du service juridique d’une entreprise, je suis retourné brièvement à la pratique d’un cabinet d’avocats au début des années 1980, avant de me voir offrir le poste de directeur juridique adjoint du service d’information, United Press International. UPI avait récemment déménagé son siège à Brentwood, Tennessee, une banlieue de Nashville, et Cathy, Andy et moi avons déménagé à Brentwood peu après.
Tout au long du 20e siècle, UPI a été en concurrence avec le plus grand syndicat de presse Associated Press. Lorsque je l’ai rejoint en tant qu’avocat général adjoint en 1984, elle venait d’être rachetée par deux jeunes entrepreneurs de Nashville. Mon engagement avec UPI n’a duré que deux ans. Pendant cette période, j’ai été aux premières loges pour voir l’entreprise glisser vers la faillite. Elle sortait tout juste de la faillite quand je suis parti. Au cours du dénouement de l’UPI, j’ai reçu une promotion sur le champ de bataille, passant d’avocat général adjoint à avocat général.
L’histoire d’UPI au cours de cette période fournit une leçon de prudence que vous pouvez emporter à la banque. Si une entreprise connaît des difficultés financières, elle a plus de chances de sombrer plus rapidement et avec certitude si elle est détenue et contrôlée par des dirigeants égocentriques et inexpérimentés qui sont dépassés et plus imbus d’eux-mêmes que de leur argent.
Étant donné l’incertitude à laquelle UPI était confrontée au moment où elle sortait de la faillite en 1985, c’est par hasard que j’ai été contacté à cette époque par un chasseur de têtes qui cherchait un nouveau directeur juridique pour l’éditeur de référence Encyclopaedia Britannica à Chicago. J’ai ensuite passé 28 ans chez Britannica, ce qui m’a donné l’occasion d’aller au-delà d’un rôle strictement juridique. Il a notamment été président de sa filiale Encyclopaedia Britannica Educational Corporation et a dirigé pendant une courte période le premier éditeur de dictionnaires du pays, Merriam-Webster.
Mon séjour chez EB m’a également permis d’avoir une vue d’ensemble de la révolution du droit de la propriété intellectuelle provoquée par l’arrivée de l’internet dans les années 1990. Alors que je connaissais depuis longtemps le droit des secrets commerciaux, des marques et des droits d’auteur pour m’adapter à la révolution de l’internet, l’émergence de l’ère numérique m’a apporté une expertise supplémentaire en matière de brevets logiciels.
Au milieu des années 80, EB avait commencé à développer une version numérique de son ouvrage de référence pour les jeunes lecteurs, Compton’s Encyclopedia. Pour un éditeur d’encyclopédies imprimées en plusieurs volumes né à Édimbourg, en Écosse, en 1768, il semble contre-intuitif d’imaginer qu’il serait à la pointe d’une invention révolutionnaire à l’ère de l’informatique.
Pourtant, à partir de l’encyclopédie multimédia Comptons, EB a réalisé à cette époque un investissement massif en recherche et développement qui a abouti à une avancée révolutionnaire dans l’évolution de l’interface homme/machine.
Pendant des décennies, Doug Engelbart, Alan Kay, Ted Nelson et bien d’autres ont lutté pour créer une interface simple qui permettrait aux humains d’interagir facilement avec les ordinateurs de l’époque. Leurs efforts de pionniers ont été limités parce que le matériel informatique de l’époque n’était pas suffisamment avancé. La souris et l’interface utilisateur graphique avaient été inventées et les contenus tels que le texte, les graphiques, la vidéo et le son pouvaient tous être numérisés à cette époque. Cependant, personne n’avait encore trouvé le moyen de rendre un contenu substantiel dans tous ces formats facilement accessible sur un ordinateur, sous une forme unifiée et cohérente, permettant la recherche.
J’ai déposé une première demande de brevet pour l’invention des Comptons de Britannica en 1989. Après une enquête approfondie sur son caractère unique, le brevet a été dûment délivré par l’Office américain des brevets et des marques en 1993. En raison de sa nature historique, la publicité qui a accompagné son émission a rapidement créé un ballon politique pour l’administration du président Bill Clinton. Les représentants des géants de la haute technologie de l’époque n’ont pas apprécié qu’une entreprise duXVIIIe siècle s’immisce dans les revenus numériques qu’ils voyaient poindre. Ils ont rapidement rencontré le vice-président Al Gore et Bruce Lehman, alors commissaire aux brevets et aux marques. Ils ont demandé une révocation rapide du brevet.
Cédant à la pression, le commissaire a rapidement ordonné un rare réexamen du brevet. La procédure a été assimilée à donner à l’agent de réexamen subordonné, si ce n’est un ordre direct, un « permis de révoquer ». En temps voulu et sans surprise, le brevet a été révoqué. Dans la première des nombreuses batailles judiciaires, EB a intenté un procès.
Après un examen approfondi et indépendant des revendications du brevet, le tribunal fédéral du district de Columbia, sur recommandation d’un maître spécial, a ordonné à l’Office des brevets de reconsidérer la révocation du brevet. L’Office des brevets a dûment réémis le brevet en 2002, neuf ans après sa délivrance initiale. Ce qui s’est poursuivi est certainement l’une des grandes sagas de notre époque en matière de litiges relatifs aux brevets. La fin est survenue près d’un quart de siècle après le dépôt initial de la demande de brevet, lorsqu’un autre tribunal a finalement décidé que le brevet n’était pas valable et qu’il n’aurait pas dû être délivré en premier lieu. Circulez les amis, ce n’est pas vraiment une invention, il n’y a rien à voir ici.
Oh et bien, tels sont les aléas du droit des brevets. Ce que l’on ne peut nier, c’est que cette avancée réalisée par Britannica a permis aux ordinateurs de dépasser leur présence limitée dans les administrations et les entreprises et de les faire entrer dans les foyers et partout ailleurs. Nous ne serions pas arrivés aussi rapidement au niveau d’immersion actuel dans le monde numérique si l’invention de Britannica en 1989 n’avait pas ouvert la voie pour donner aux enfants, même très jeunes, la possibilité de rechercher et de naviguer facilement dans un texte riche, des images, des vidéos et des éléments sonores.
En 1971, alors que je décompressais après trois années passées dans l’armée, j’ai essayé brièvement, après ma démobilisation, d’écrire sur les événements inhabituels auxquels j’avais participé au cours de ces trois années. Si j’avais fini un tel récit, il aurait pu s’intituler « Un fantôme parle ». Au lieu de cela, j’ai rempli la pause que j’avais prévue dans mon emploi du temps pour cet effort d’écriture en voyageant en Europe et au Moyen-Orient. Mes vacances terminées, je suis retourné à Chicago pour recommencer ma vie d’avocat.
J’avais 28 ans et j’étais toujours célibataire quand je suis sorti de l’armée. Bien que j’aie toujours eu en tête l’objectif de me marier et de fonder une famille, j’étais déterminée à rester célibataire à ce moment-là. Je ne me sentais pas assez établi financièrement pour penser au mariage et à une famille, et je me contentais encore de fréquenter des gens. À cette époque, je ne pensais pas à m’engager à long terme avec qui que ce soit.
En 1974, mon attitude à l’égard du mariage s’était peu à peu transformée et j’avais épousé Judy Arndt, la belle-sœur de mon collègue du cabinet d’avocats Bill Singer. Le mariage n’a pas duré longtemps, et ma vie personnelle ayant été mise en veilleuse pendant un certain temps, je me suis lancé dans la politique locale tout en continuant à développer mes compétences professionnelles en tant qu’avocat d’affaires représentant des entreprises.
Bien que je n’aie pas eu autant de chance dans l’évolution de ma vie personnelle, j’ai pris un bon départ dans le droit chez Roan & Grossman au début des années 1970. J’ai découvert que j’aimais mes clients et la pratique du droit, et mes clients semblaient apprécier de m’avoir comme avocat. Ainsi, au fil des années, j’ai pris de l’assurance sur le plan professionnel et j’ai également mûri sur le plan personnel. Je me suis remarié en 1979 et Cathy Vanselow et moi avons commencé la vie de famille plus tôt que prévu avec la naissance prématurée de notre fils Andy l’année suivante. Je me suis détourné de la pratique privée du droit lorsque j’ai eu l’occasion de devenir le directeur juridique d’une société d’objets de collection basée à Chicago et ayant d’importantes activités à l’étranger. Ce travail m’a permis de découvrir le droit international et a complété mon développement en tant que juriste d’entreprise spécialisé dans la propriété intellectuelle.
La principale activité de la société à l’époque était la vente de plaques de collection en édition limitée. On aurait pu les confondre avec de la vaisselle, si ce n’est que les ébauches d’assiettes en argile avaient été cuites dans un four avec des motifs décoratifs. La plupart d’entre eux ne passaient généralement pas au lave-vaisselle et vous ne pouviez pas manger de nourriture sur les assiettes de collection en raison de la toxicité intégrée de leurs peintures et teintures.
Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas l’excitation et le plaisir de vendre des assiettes qui m’ont poussé à accepter ce poste. Pour moi, cela tenait plutôt au fait que l’entreprise appartenait à Rod MacArthur (J. Roderick MacArthur), le fils du milliardaire John D. MacArthur, récemment décédé. À sa mort, John D. MacArthur serait le deuxième Américain le plus riche et il aurait laissé l’essentiel de sa fortune non pas à son fils Rod et à sa fille Virginia, mais à la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur. La fondation MacArthur est immédiatement devenue l’une des plus grandes fondations du pays.
Rod avait besoin d’un avocat pour son entreprise d’objets de collection en pleine expansion, et il avait également besoin d’un avocat pour lui fournir une aide et des conseils juridiques dans l’exercice de ses fonctions de plus en plus acrimonieuses de directeur de la Fondation. Avant que son irritation à l’égard de ses collègues directeurs de fondation ne se transforme en procès, Rod a pris l’initiative de développer le programme de bourses de la Fondation MacArthur, plus connu sous le nom de bourses « Genius ». Bien que Rod puisse être parfois excentrique et acariâtre, je m’entendais bien avec lui et j’ai apprécié son offre de fournir une expertise en matière de vente par correspondance lorsque j’ai décidé, en 1979, de me présenter contre un candidat soutenu par la machine Daley pour le 43e district du comité démocratique. J’ai quitté la société de Rod MacArthur au début des années 1980 lorsque je me suis à nouveau dirigé vers des eaux inconnues en tant que conseiller juridique interne d’UPI.